
C’est aujourd’hui la journée mondiale des micro et petites entreprises des Nations Unies. J’ai plaisir à cette occasion à republier cette tribune écrite par Simon BALITEAU et Williams Irié POIN d’Agrisud International. Dans la séquence politique tumultueuse traversée par le pays, les micro-entrepreneuses d’Adattié nous rappellent combien les enjeux d’aide au développement sont, comme ceux du climat, dramatiquement absents du débat public.
L’attiéké est une spécialité culinaire traditionnelle des habitants du sud de la Côte d’Ivoire à base de semoule de manioc fermenté. Majoritairement produit par une myriade d’unités artisanales tenues par des femmes, l’attiéké est désormais consommé dans l’ensemble du pays. La professionnalisation de ces unités pour en faire des micro-entreprises viables et la défense du foncier agricole face aux pressions de l’urbanisation permettent de faire reculer la pauvreté et contribuent à la sécurité alimentaire ivoirienne. Focus sur l’expérience pilote du village d’Adattié, dans la périphérie d’Abidjan.
Transformer le manioc sur des foyers trois pierres
L’entreprise traditionnelle type produisant l’attiéké est constituée d’un capital rudimentaire : un foyer trois pierres brûlant de la biomasse, quelques bassines et une presse à vis difficile à manier. Le savoir-faire se transmet par voie orale d’une génération à l’autre. L’activité repose exclusivement sur de la main-d’œuvre féminine, essentiellement familiale, à qui est dévolue cette activité. Les rendements sont faibles, les conditions de travail sont éprouvantes, voire dangereuses (toxicité des fumées). Les marges sont très incertaines et maintiennent les familles vivant de cette activité dans la grande pauvreté. La pression foncière en zone périurbaine a aggravé cette situation : la réduction des surfaces disponibles pour la culture du manioc entraîne une hausse régulière de son prix qui représente les 2/3 du coût de production.
Dans un premier temps, les politiques locales ont favorisé le saut vers des unités semi-industrielles : regroupements d’une quinzaine de femmes dans des bâtiments neufs, équipés d’une broyeuse motorisée, d’essoreuses, de semouleuses et de foyers à gaz. Ce double saut d’échelle et de technologie devait permettre de satisfaire la demande nationale et un marché naissant à l’exportation.
Les résultats ont été mitigés, notamment du fait de l’irrégularité de l’approvisionnement en matière première conduisant à une très faible utilisation des nouvelles capacités installées. C’est pourquoi le District autonome d’Abidjan mise désormais sur la professionnalisation des micro-entreprises artisanales de transformation dans le cadre du projet pilote PROFIT (Promotion de Filières agricoles Territorialisées), visant à constituer une filière d’approvisionnement en attiéké en partenariat avec des ONG de développement et la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire.
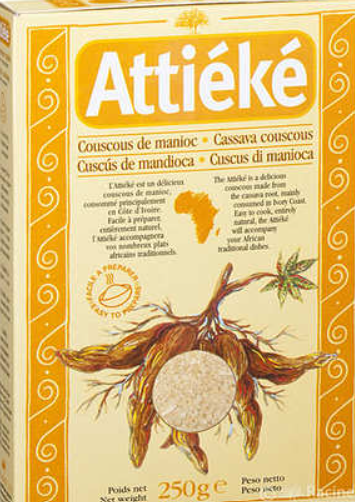
Un projet pilote dans la périphérie d’Abidjan
Cela passe en premier lieu par des améliorations apportées dans l’activité de transformation elle-même. Grâce à des actions de sensibilisation et de formation, les équipements les plus rudimentaires ou dangereux peuvent être remplacés à moindre coût. Le passage à des foyers améliorés pour la combustion (permettant de réduire par 2 la consommation en bois) et à des presses à vérin mieux adaptées accroît l’efficacité des procédés, réduit la pénibilité des tâches et améliore les conditions sanitaires.
L’investissement de départ qui s’effectue dans le cadre de formations collectives est aussi une première étape dans l’apprentissage managérial des micro-entrepreneuses qui peuvent regrouper les achats, échanger des informations sur les débouchés pour mieux organiser et valoriser l’accès au marché local.

Les limites de l’action conduite à l’échelle des entreprises apparaissent alors rapidement. Toutes les contraintes ne peuvent être levées au niveau des micro-entreprises de transformation, surtout s’il s’agit d’élargir l’activité. Pour développer la filière, il faut pouvoir approvisionner les ateliers de transformation en quantité et surtout en qualité (taux de fibre et de matières sèches).
Or la culture traditionnelle du manioc a été concurrencée par l’expansion des cultures de rente (hévéa, palmier à huile). Le projet PROFIT comporte donc un volet agricole, destiné à améliorer les pratiques culturales à l’amont de la filière. Sur les petites exploitations agricoles vivrières, des techniques simples et peu coûteuses, comme la diffusion de variétés de manioc plus adaptées, permettent d’accroître rapidement et durablement les rendements et les marges à l’hectare.
Mais là encore, les entreprises agricoles n’ont pas toutes les clefs en main. La pression exercée sur le foncier est très forte dans les zones périurbaines où est cultivé le manioc. Le projet PROFIT comporte aussi un volet territorial, reposant sur une dynamique multi-acteurs visant à préserver les terres agricoles face à l’extension des lotissements. Un groupe de travail a également été mis en place afin d’améliorer l’état des pistes locales, au travers d’actions collectives d’entretien et de la recherche de partenaires institutionnels pouvant appuyer la réhabilitation de certains tronçons.
En trois ans, plus de 170 femmes produisant de d’attiéké ont été professionnalisées, et ont pu accroître leur marge par tonne de manioc transformé.
Du pilote à l’essaimage
Au vu des résultats atteints, le projet pilote PROFIT est en train de changer d’échelle. Avec le soutien financier de l’Union européenne et de l’Agence française de Développement (AFD), 1 000 exploitations agricoles familiales et 200 micro-entreprises agro-alimentaires vont être intégrées dans les 3 régions limitrophes d’Abidjan, afin d’améliorer la filière attiéké locale. En plus du renforcement technique et en gestion économique, ces entrepreneuses seront accompagnées sur les volets commercialisation et accès au crédit, l’objectif étant d’améliorer la viabilité et la durabilité de ces micro-entreprises pour rendre plus attractif ce métier, souvent choisi par défaut par les femmes. Une avancée obtenue grâce au dynamisme de micro-entrepreneuses qui fait boule de neige et contribue à l’amélioration des approvisionnements alimentaires à partir des ressources locales tout en faisant reculer la pauvreté.